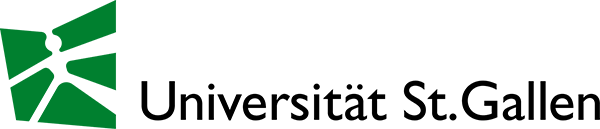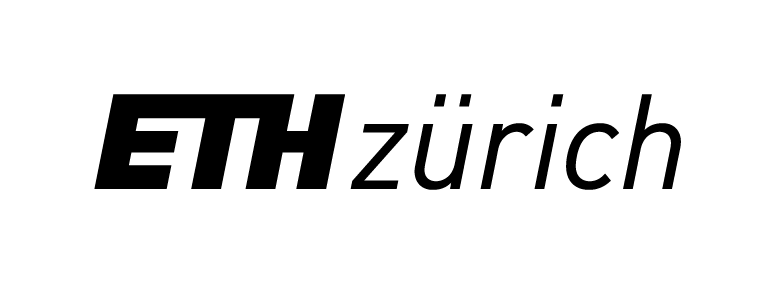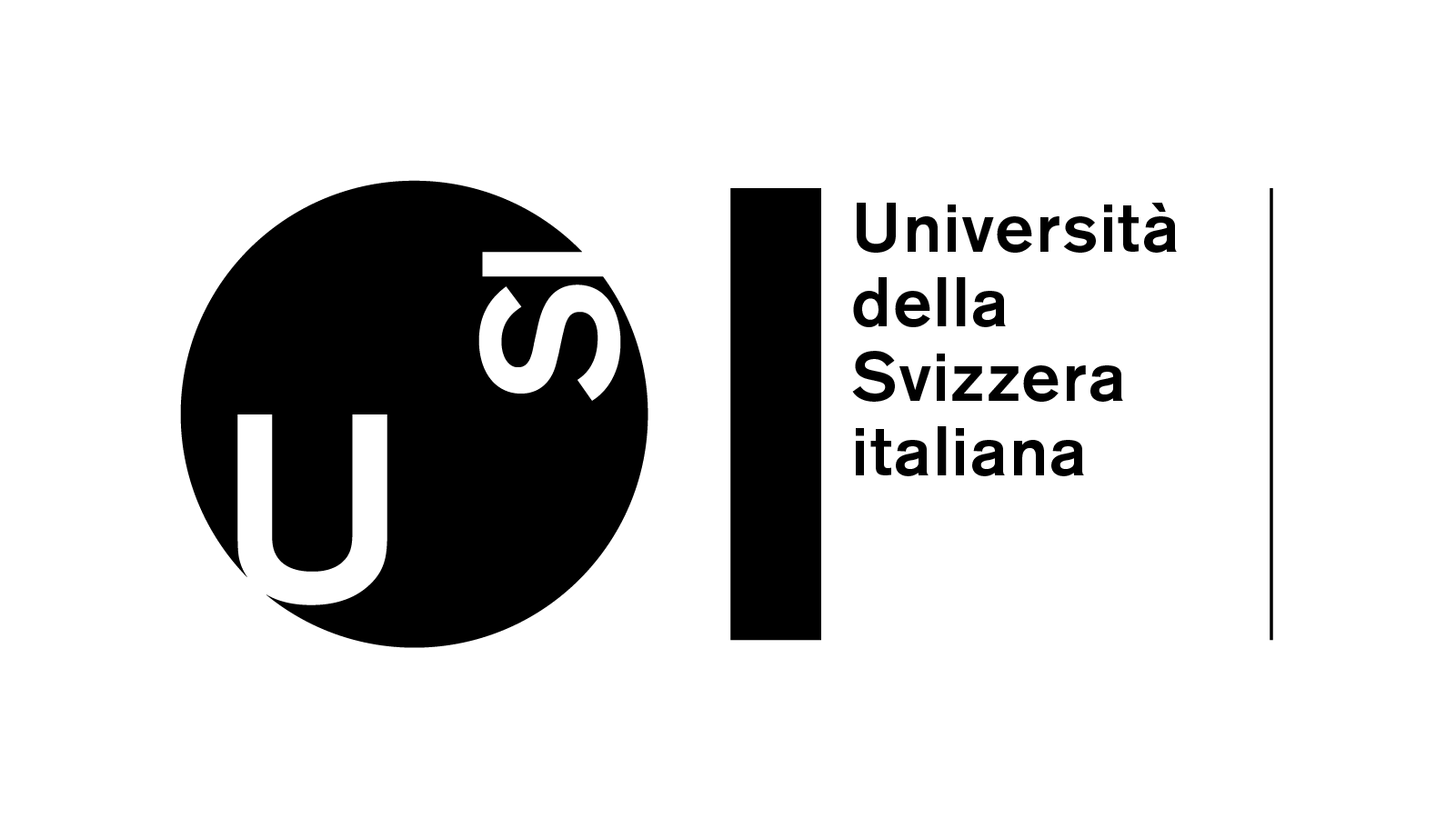Max
Assistant scientifique à l’ETH, doctorant, cofondateur du premier réseau suisse First-Gen
Question 1 : Te souviens-tu comment tu as décidé de faire des études supérieures en général, et dans une discipline en particulier ? Qui ou quoi a influencé ta décision ?
En gros, j’étais au lycée après avoir eu de bonnes notes à l’école primaire. J’ai commencé mon parcours éducatif en Allemagne, obtenu mon Abitur (Matura), et là s’est posée la question : que faire ensuite ?
Dans mon entourage, beaucoup ont suivi une formation professionnelle. Étudier n’a jamais été un sujet pour moi, et l’université était une institution abstraite pendant mon Abitur, pas une réalité. Après le bac, j’ai travaillé avec mon père sur des chantiers, mais ça n’a pas bien marché—je suis maladroit.
Après des discussions avec mes parents, l’idée d’étudier est apparue. C’était flou au début, mais on a décidé d’essayer. Mes parents, réfugiés de la guerre en Yougoslavie, n’ont jamais eu cette chance, donc ils m’ont encouragé. J’ai postulé en psychologie, pensant ne pas être accepté. Contre toute attente, j’ai été admis.
Question 2 : Comment as-tu vécu le début de tes études ? Comment t’es-tu senti et adapté au départ, et comment cela s’est-il passé ensuite ?
Au début, je me sentais présent, mais pas vraiment intégré. En psychologie, j’ai vite côtoyé des gens issus de milieux plus privilégiés. Pas que je sois défavorisé, mais eux avaient plus d’avantages. De petits détails me faisaient sentir que quelque chose clochait.
Des phrases comme “J’ai fait du Work and Travel en Australie cet été” m’ont montré que ces expériences étaient hors de mon monde. Mais j’ai aussi rencontré des gens comme moi. Ces petites différences ont créé un sentiment de venir d’un autre monde—sans pouvoir le nommer.
Les idées de volontariat ou d’année sabbatique ne faisaient pas partie de ma réalité. Pour moi, après l’école, on cherche un travail. C’est la vie : tu finis un job, tu passes au suivant. Je n’ai pas reçu de critiques, mais je me sentais différent. Je portais volontairement des joggings à la fac pour affirmer cette différence—un mécanisme d’adaptation.
L’intégration s’est bien passée au premier semestre. Je ne me suis jamais senti exclu, juste avec une perspective différente. Vers la fin du deuxième semestre, j’ai commencé à me sentir à ma place.
J’ai cru comprendre comment le système fonctionnait—du moins je le pensais. Un grand changement a été de découvrir les opportunités de développement personnel à l’université. Avant, s’engager dans un club scolaire semblait réservé aux “intellos”. À la fac, j’ai vu que c’était fun et enrichissant.
Le groupe Arbeiterkind.de à Constance, fondé quand j’étais en deuxième ou troisième semestre, m’a beaucoup aidé. Il m’a permis de parler de sujets comme la vision familiale des études, la fin des études, ou les projets futurs. Être perdu face au choix des séminaires ou à l’avenir est courant.
Je pensais être dans le bain, mais pas vraiment. Une fois que j’ai compris le fonctionnement de la fac, une autre incertitude est apparue : comment gérer les études et la famille ? Et à la fin, le doute est revenu : que faire après le bachelor ?
Question 3 : Tu as mentionné que ta famille a joué un rôle décisif au début dans le choix des études, qu’elle était ouverte et soutenante. Mais tu as aussi dit qu’ensuite, tu as dû gérer les études et la famille. Que veux-tu dire par là ?
Alors, une chose est certaine : il y a un aspect financier. Faire des études, il faut pouvoir se le permettre. Fondamentalement, je dirais que ce n’était jamais un problème dans le sens où mes parents auraient dit : “On ne peut pas se le permettre.” C’était plutôt évident que je travaillerais. Je ne sais pas, le sujet n’a jamais été abordé, cette question ne s’est pas posée — je travaillais, tout simplement.
Et j’ai aussi eu énormément de chance avec le Bafög (aide financière étudiante). Je pense qu’il faut vraiment dire que cette bourse a été un sauveur dans ce contexte. Donc, d’un côté, il y avait l’aspect monétaire, mais de l’autre, aussi un peu cette dimension où personne ne sait vraiment ce que signifie “faire des études”, mais cela fait quand même partie de la réalité. Quand je rentrais chez moi et que je disais : “Les études, c’est super stressant”, j’entendais des commentaires du genre : “Pourquoi tu te plains ? Moi, je travaille huit heures par jour sur les chantiers. Tu veux finir comme moi ?” Et là, tu te dis : non, je ne veux pas. J’accepte totalement que ton travail est l’un des plus durs qu’on puisse faire sur cette planète, mais j’aimerais quand même avoir un espace pour pouvoir dire : “Je suis à bout.”
Et je pense que ce manque de compréhension sur à quel point les études peuvent être éprouvantes était difficile. Et aussi toute l’incertitude qui y est liée, parce qu’on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer, et parce que c’est beaucoup moins structuré que ce qu’on connaît à l’école. Il m’a fallu une éternité pour comprendre qu’il est normal de ne pas aller à tous les cours. Pour moi, jusqu’au troisième ou quatrième semestre, c’était évident : je vais en cours, parce que c’est sur mon emploi du temps. Mais au final, personne ne s’intéresse à savoir si tu y es allé ou non.
Un autre aspect était l’éloignement de ma propre famille, en termes de pertinence et de sujets. Pour mes parents, avoir une voiture était important, alors que moi je préférais économiser mon argent. Les discussions ne faisaient pas partie de notre culture familiale, alors qu’elles jouent un rôle central dans les études.
À l’université, on entre dans un monde intellectuel où des sujets comme le genre ou la société post-migratoire sont pertinents. Ces thèmes ont souvent provoqué des malentendus avec mes parents, qui disaient alors : “Voilà le diplômé.” Il m’a fallu du temps pour apprendre à gérer cela.
Question 4 : Tu as mentionné des questions de financement. Peux-tu donner des exemples de la manière dont cela a pu influencer tes études ?
Je pense qu’une chose que je n’ai comprise qu’après coup, et qui a vraiment marqué l’aspect financier pour moi, c’est le respect de la durée réglementaire des études. Dès le début, il était clair pour moi que je devais terminer mes études dans le temps imparti, car sinon je perdrais ma bourse, et sans bourse, pas de Zoran à l’université.
C’est pourquoi des choses comme un semestre à l’étranger ou une prolongation n’ont jamais été envisagées. C’était simplement évident que je devais finir dans les délais. Une anecdote à ce sujet : au troisième ou quatrième semestre, une réévaluation de mon Bafög (aide financière étudiante) a eu lieu, et soudain on m’a dit que je ne recevrais plus que 180 €. Cela m’a complètement déstabilisé pendant trois semaines, jusqu’à ce qu’on découvre qu’il s’agissait simplement d’une erreur de saisie. Cette incertitude a déclenché des angoisses existentielles. Travailler en parallèle de mes études était normal pour moi, je ne connaissais pas les études sans travail. Cela signifiait que je devais organiser mon temps de manière très rigoureuse.
Concernant la durée réglementaire, je savais que le Bafög pouvait être prolongé en cas de raisons valables, mais la définition de “valable” était floue. Les activités bénévoles auraient pu en être une, mais cela ne faisait pas partie de mon univers. Les demandes étaient souvent intimidantes et incompréhensibles, et j’ai eu la chance que ma mère travaille dans l’administration et puisse m’aider. Il est important de supprimer les obstacles inutiles.
Question 5 : Quelle a été ton expérience après ton premier diplôme, et comment as-tu planifié les étapes suivantes ?
Après mon premier diplôme, j’ai réalisé que j’avais considéré mes études comme une simple liste de crédits ECTS à valider. J’avais négligé le fait qu’on peut façonner son parcours universitaire. D’autres avaient fait des stages et savaient dans quelle direction aller, alors que moi je n’avais aucune idée. J’ai donc décidé de faire un master, parce que je ne savais toujours pas où aller.
En psychologie, il n’y avait à l’époque qu’un seul master, donc je n’avais pas d’autre option. Ce n’est que plus tard que j’ai compris que j’aurais pu faire un master dans une autre discipline. Pendant le master, j’ai eu plus de contacts avec des chercheuses et d’autres personnes qui m’ont montré de nouvelles voies. Pourtant, je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise en psychologie, mais j’ai continué sur cette voie.
Ma famille ne pouvait pas vraiment m’aider, car elle ne savait pas comment me soutenir. Mes amis avaient souvent déjà des objectifs clairs, alors que moi j’étais encore dans le flou. Avec le recul, une année de pause après le lycée m’aurait fait du bien, pour mûrir en tant que personne et mieux structurer mes études.
Aujourd’hui, je fais un doctorat à l’ETH. Pour moi et beaucoup d’autres issus de milieux First-Gen, le doctorat représente le plus haut diplôme académique et une suite logique. Je ne savais pas quel métier me conviendrait, mais la recherche me plaisait, alors j’ai tenté. Peut-être que je voulais simplement écrire cette histoire dans ma vie.
Après le master, il était clair pour moi que je devais enchaîner immédiatement. C’est une façon de penser typique du milieu ouvrier, où travailler fait partie intégrante de la vie. Je n’avais pas d’idée précise de ce que fait un psychologue en dehors de l’université, mais le quotidien universitaire m’était familier.
Question 7 : Quels sont tes conseils pour les étudiants First-Gen ?
Un conseil que je me donnerais à moi-même serait de prendre son temps et d’être plus indulgent envers soi-même. Il est important de ne pas trop se stresser si on n’a pas encore de plan, même quand les autres semblent tout maîtriser.
Un autre paradoxe, c’est que lorsqu’on célèbre le fait d’être First-Gen, on donne moins de poids à ce passé. Cela aide à s’expliquer sans se culpabiliser, et réduit l’impact de ce contexte sur sa propre vie.
Façonne tes études et saisis l’opportunité de faire des choses qui peuvent sembler inutiles. Les plus belles expériences naissent souvent quand on essaie quelque chose de nouveau. Que ce soit un cours de peinture ou des cours supplémentaires de philosophie, essaie simplement.
Il est important de saisir les opportunités et de ne pas trop réfléchir à tout. Il faut trouver un équilibre entre les choses qui se présentent et celles qu’on poursuit activement. Souvent, c’est moins grave qu’on ne le pense.
Le réseautage et les échanges avec d’autres personnes ayant un parcours similaire sont extrêmement précieux. Ces rencontres peuvent être décisives pour obtenir des informations et du soutien. Les personnes et les organisations qui comprennent ce contexte sont cruciales pour le parcours.
Au nom de l’égalité des chances : prenez ces bourses.
Amusez-vous aussi pendant vos études. Et la question du financement permet justement ce plaisir, car vous êtes plus serein que si vous deviez encore vous en soucier. Profitez de tout ce à quoi vous avez droit.
Expliquez à vos parents ce que signifie faire des études—c’est un travail difficile.
Et gardez les yeux et les oreilles ouverts, et développez un réseau large.